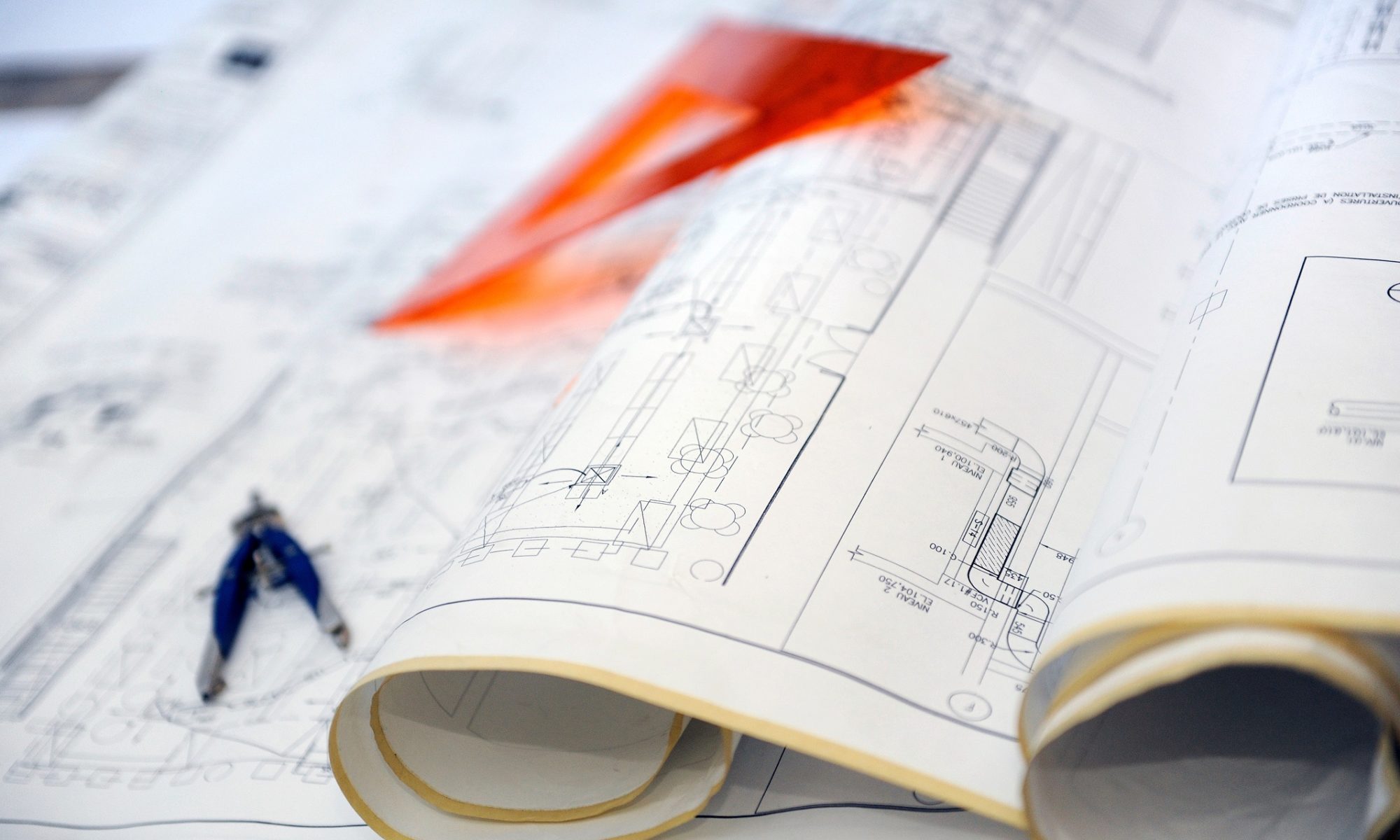Un logement confortable et fonctionnel, c’est ce que chacun recherche au quotidien. Mais que se passe-t-il lorsque survient un accident, une perte de mobilité, ou simplement avec le temps qui passe ? Trop souvent, l’adaptation du logement devient une urgence plutôt qu’un choix anticipé. Pourtant, penser à l’accessibilité dès la construction ou lors d’une rénovation est un véritable levier de confort, d’autonomie et de valorisation de votre bien.
Pourquoi anticiper l’accessibilité de son logement ?
Une réalité pour tous : vieillissement, accident, handicap temporaire ou permanent
« Une personne qui a un accident de vie, une personne née avec un handicap ou une personne souhaitant vieillir dans son logement peut avoir besoin d’un logement accessible. »
Clément Bodilis, FLEC
Ces situations peuvent toutes rendre le logement d’origine inadapté, voire dangereux. Anticiper, c’est éviter de devoir tout réaménager dans l’urgence.
« Il est nécessaire de penser à l’adaptabilité de son logement quand on arrive à 50-60 ans. »
Clément Bodilis, FLEC
C’est souvent à ce moment-là qu’il devient judicieux d’envisager certains aménagements avant qu’ils ne deviennent indispensables.
Les bénéfices : autonomie, confort, valorisation du bien
Un logement accessible ne profite pas seulement aux personnes en situation de handicap. Il facilite la vie de tous : jeunes parents avec poussette, seniors, personnes convalescentes… De plus, un bien adaptable est souvent mieux valorisé sur le marché immobilier, car il répond à des besoins croissants dans la société.
« Même si on ne peut pas procéder à la mise aux normes PMR de son logement dans l’immédiat, il est important de l’anticiper pour que ce soit plus facile à réaliser ensuite. »
Clément Bodilis, FLEC
Prévoir en amont certains aménagements rendra leur mise en œuvre plus simple et moins coûteuse le moment venu.
Une démarche responsable et inclusive
Penser accessibilité, c’est aussi adopter une vision solidaire de l’habitat. En rendant les logements utilisables par tous, sans distinction, vous participez à une société plus inclusive et respectueuse des parcours de vie de chacun.
Quelles sont les normes et réglementations en vigueur ?
Qu’est-ce qu’un logement PMR ?
Un logement PMR (Personne à Mobilité Réduite) est conçu ou aménagé pour permettre à toute personne, quelles que soient ses capacités physiques, de s’y déplacer, s’y repérer et y utiliser les équipements de manière autonome.
« Le passage des portes est la principale source de problème dans un logement quand on est handicapé. Par exemple, beaucoup de logements, en général des années 60-70, ont des portes en 73 cm, alors que le passage d’un fauteuil roulant nécessite des portes de 93 cm dans l’idéal. »
Clément Bodilis, FLEC
Ce type de contrainte illustre bien la nécessité d’anticiper certaines dimensions dans les plans ou travaux.
Le cadre réglementaire : construction neuve et rénovation
Dans le neuf, les logements en rez-de-chaussée ou accessibles par ascenseur doivent respecter des normes d’accessibilité précises, fixées par le Code de la construction et de l’habitation. En rénovation, l’obligation est plus souple, mais il est fortement recommandé de se rapprocher des recommandations en vigueur pour anticiper les besoins futurs.
« Qu’il s’agisse d’un logement neuf ou d’un logement à rénover, on pense peu aux normes PMR, on privilégie l’instant T. Ainsi, si on doit ajouter des mètres carrés, on va préférer le faire pour la pièce de vie, plutôt que pour les toilettes et la salle de bains. »
Clément Bodilis, FLEC
Pourtant, ces pièces techniques sont souvent celles qui demandent le plus d’adaptations spécifiques.
Des aides disponibles pour financer les travaux
Depuis janvier 2024, MaPrimeAdapt’ permet de financer une partie des travaux nécessaires à l’adaptation du logement. Cette aide s’adresse aux personnes âgées ou en situation de handicap, sous conditions de ressources. D’autres dispositifs existent, comme ceux proposés par l’ANAH, les caisses de retraite ou les collectivités locales.
Comment concevoir ou adapter un logement accessible ?
Adapter son logement existant : les points clés
Lorsqu’il s’agit de rendre un logement accessible, certains aménagements sont prioritaires. Il convient d’agir sur la circulation intérieure (espaces de rotation, suppression des seuils), la salle de bains, les toilettes, ou encore la cuisine.
Des aménagements simples mais efficaces
Vous pouvez déjà améliorer sensiblement l’accessibilité de votre logement avec quelques gestes :
Installer des barres d’appui dans la salle de bains ou les toilettes
Remplacer la baignoire par une douche de plain-pied
Poser des poignées ergonomiques
Élargir les passages de portes si cela est possible
Prévoir une suite parentale au rez-de-chaussée
Optimiser la largeur des accès, même si les normes PMR ne peuvent être respectées entièrement.
« Pour les aidants aussi, il est impératif d’avoir un logement adapté PMR, notamment dans les réadaptations de douche. La robinetterie doit être adaptée aussi à l’aidant, pour qu’il puisse procéder à la toilette de manière la plus simple possible. »
Clément Bodilis, FLEC
L’accessibilité concerne donc aussi ceux qui accompagnent au quotidien.
« La cuisine est d’emblée la pièce qui ne sera pas à la bonne hauteur, donc ça fera partie des éléments à adapter. Ca reste des meubles à changer, donc c’est plus simple. Habituellement, les plans de travail ont une hauteur de 90-93 cm, les normes PMR fixent une hauteur idéale à 85 cm. »
Clément Bodilis, FLEC
Un exemple concret de petit ajustement aux grandes conséquences.
Concevoir un logement neuf avec une vision d’avenir
Si vous faites construire, profitez-en pour intégrer dès le départ une logique de logement évolutif. Prévoyez des pièces modulables, une salle d’eau au rez-de-chaussée, ou encore des gaines techniques permettant l’installation future d’un monte-escalier.
« Pour optimiser l’accessibilité de son logement, il est important d’anticiper le plus possible. Quitte parfois à changer de maison et en racheter une autre. »
Clément Bodilis, FLEC
Dans certains cas, il peut être plus simple et pertinent de repenser complètement son cadre de vie.
Faire appel aux bons professionnels
Pour un diagnostic précis et des solutions adaptées, n’hésitez pas à consulter un ergothérapeute ou un architecte spécialisé dans l’accessibilité.
« L’ergothérapeute est une personne clé dans l’adaptation PMR d’un logement. Elle apporte des conseils et conçoit les plans. »
Son expertise est précieuse pour combiner accessibilité, confort et réalisme budgétaire.
Vers une accessibilité universelle : un enjeu de société
Une démarche au-delà du handicap : le logement évolutif
Un logement bien pensé aujourd’hui, c’est un lieu de vie qui vous accompagne demain. L’accessibilité n’est pas synonyme de médicalisation, elle est synonyme de liberté. Concevoir un logement qui s’adapte, c’est investir dans sa qualité de vie sur le long terme.
Favoriser le maintien à domicile et éviter les ruptures de parcours de vie
Adapter son logement permet aux personnes âgées ou en situation de handicap de continuer à vivre chez elles, dans leur environnement familier. C’est une alternative durable et humaine aux structures spécialisées, souvent coûteuses ou éloignées du cadre de vie habituel.
Anticiper l’accessibilité d’un logement, ce n’est pas simplement se conformer à une réglementation. C’est faire le choix d’un habitat accueillant, évolutif et respectueux des besoins de chacun. Que vous soyez en phase de construction ou de rénovation, de nombreuses solutions existent pour rendre votre logement plus inclusif. Et avec les aides disponibles comme MaPrimeAdapt’, il n’a jamais été aussi accessible… d’être accessible.
Plus d’info dans le podcast De la Cave au Grenier disponible sur toutes vos plateformes d’écoute